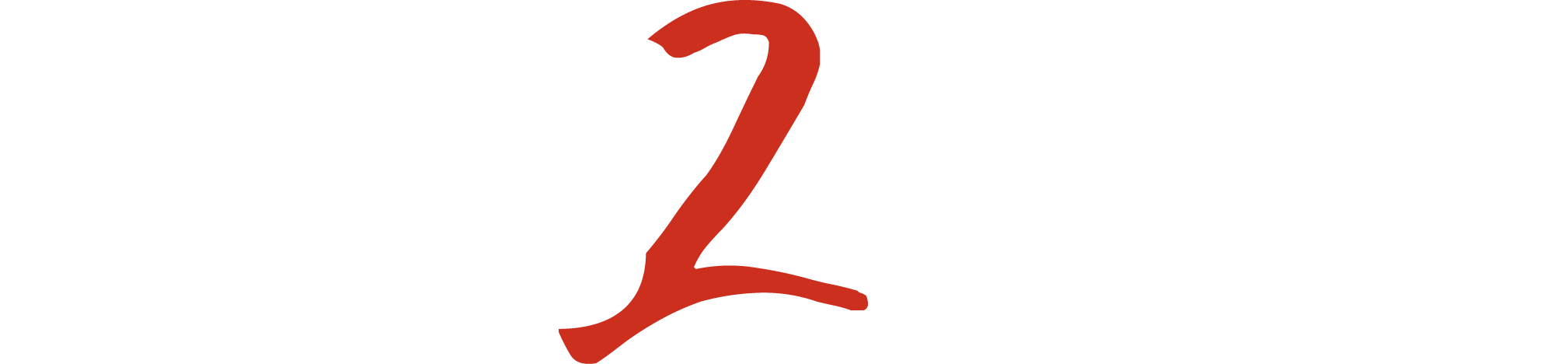Plus de 14 ans plus tard, on évoque encore le séisme en faisant allusion au tremblement de terre. Le palais national n’a toujours pas été relevé de ses ruines, malgré des fonds disponibles pour sa reconstruction. De même, les bâtiments publics symbolisant l’État restent en décrépitude. La mémoire douloureuse persiste, marquée par de nombreuses personnes tuées et disparues lors du séisme. Le lieu de mémoire consacré aux victimes du 12 janvier suscite la polémique, étant actuellement sous le contrôle de groupes armés aux environs de l’axe de la route nationale #1.
Le repositionnement du pays dans l’espace humanitaire international depuis cette date doit également être mentionné. Bien qu’il y ait eu une solidarité internationale à l’époque, plus de 14 ans après, il est clair que le pays est devenu beaucoup plus dépendant de la communauté internationale, en particulier des organisations non gouvernementales. Cette solidarité dans la dépendance souligne que les décisions et financements concernant la reconstruction ont été largement dictés par la communauté internationale, avec un alignement de l’État haïtien historiquement dépendant.
Il devient évident que malgré les dispositions constitutionnelles de la Constitution de 1987, aucune politique de logement et d’aménagement territorial n’a été mise en place. Les constructions anarchistes du littoral et des bassins versants, alimentées par la migration due à la violence systématique envers les habitants du milieu rural, ont exacerbé les problèmes dans les grandes villes, notamment à Port-au-Prince, mal préparée pour une telle croissance.
Au lieu de responsabiliser l’État, la catégorie des paysans, à la fois main-d’œuvre économique et outils politiques, a été blâmée pour la construction anarchique. La communauté internationale, en tant que vecteur de solidarité, a montré sa force politique en monopolisant l’organisation et la distribution de l’aide humanitaire, occupant même l’aéroport international comme porte d’entrée aérienne du territoire. Malgré un budget de plus d’un milliard de dollars américains, les réalisations concrètes ont été limitées, suscitant des doutes quant à la propagande de l’époque.
Les organisations non gouvernementales, se prévalant de la solidarité internationale, ont participé ouvertement à ce gaspillage massif. Quatorze ans plus tard, l’insécurité liée au logement persiste et s’aggrave en Haïti. Le pays est maintenu sous perfusion humanitaire, soulignant l’urgence d’un débat approfondi sur l’action humanitaire dans la région.
Depuis son rattachement à la communauté internationale, des époques coloniales à l’impérialisme, et maintenant à l’humanitaire, tout semble être utilisé pour maintenir le pays sous l’emprise des grandes puissances, avec la complicité d’acteurs politiques et économiques internes. Le parcours d’Haïti au sein de cette communauté, comme le souligne Ricardo Seintefus dans son ouvrage sur l’échec de l’aide internationale en Haïti, a été entaché d’une grande solitude.
Mag.2 News