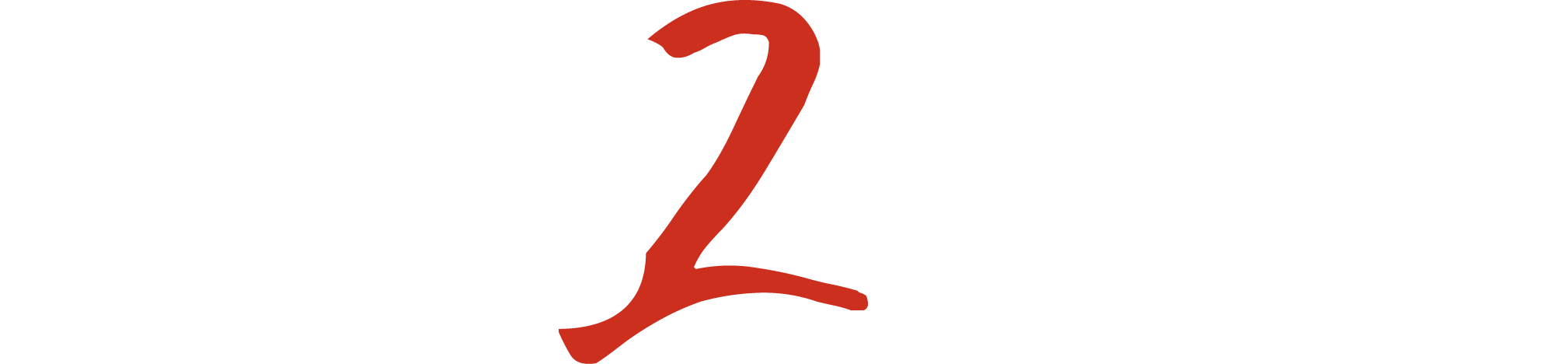« J’ai entendu parler de cas où des Haïtiens se sont livrés au vol de nourriture et de bétail appartenant à des fermiers dominicains. En réponse aux plaintes des Dominicains concernant ces actes de déprédation perpétrés par des Haïtiens vivant parmi eux, je dis que nous devons trouver une solution à ce problème. En fait, nous avons déjà commencé à le faire. À Banica, environ trois cents haïtiens ont été tués, et nous devons continuer à résoudre ce problème. » Ces propos ont été tenus par le chef d’État de la République dominicaine à l’époque, Rafael Leónidas Trujillo, en 1937, lors d’une visite à Dajabón au cours de laquelle il a prononcé un discours devant la foule venue l’accueillir.
Plus de 86 ans plus tard, le souvenir de cet événement douloureux reste profondément ancré dans la mémoire collective des Haïtiens. Les conséquences liées aux travaux d’irrigation dans le Nord-Est ont ravivé la triste notoriété du Massacre des Haïtiens en République dominicaine. Entre le 2 et le 4 octobre 1937, selon Suzy Castor, les Haïtiens, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes ou d’enfants, qui résidaient de l’autre côté de la ligne frontalière, ont été victimes de violences brutales infligées par des militaires et des civils dominicains, agissant sous l’ordre direct de Trujillo.
Les victimes se comptent par milliers. Elles ont été noyées, jetées en mer pour servir de proie aux requins, assassinées dans les bois et leurs corps abandonnés dans des fosses communes, dont l’emplacement demeure encore inconnu à ce jour. Le nombre exact de victimes demeure incertain, car chaque partie impliquée dans cette tragédie avance des chiffres différents. Cependant, il est indéniable que des milliers de Haïtiens ont perdu la vie. Ce tragique événement constitue un génocide, un crime d’État perpétré par Trujillo et son entourage, dans des circonstances tragiques et variées.
D’abord, sur le plan politique, l’occupation américaine de l’île a eu un impact significatif sur l’organisation et l’évolution conjointe et séparée des deux États. Il convient de noter que l’Accord de 1929, qui a défini définitivement la frontière, a été négocié sous le regard bienveillant de l’impérialisme américain. Dès lors, les structures économiques et politiques ont été largement influencées par les intérêts des entreprises et de la haute finance américaine.
En transformant la République dominicaine en un espace de production avec ses nombreuses centrales sucrières, et Haïti en fournisseur de main-d’œuvre bon marché, l’objectif était de libérer les terres au-delà de la frontière au profit des entreprises américaines implantées dans l’île. La dominicanisation de la frontière est ainsi devenue un acte à la fois politique et économique visant à renforcer l’hégémonie de la République dominicaine sur toute l’île, la frontière étant un espace capital.
Outre l’hégémonie politique, la dominicanisation de la frontière a permis à l’oligarchie dominicaine de contrôler, dans son intérêt, le flux migratoire des travailleurs haïtiens. La crise du système financier américain, qui investissait dans ces zones de production délocalisées, a eu d’importantes répercussions sur leur productivité. Les importations de ces produits ont été ralenties en raison du protectionnisme, entraînant une surproduction. Pour résoudre ce problème, les oligarchies ont décidé de réduire le flux migratoire, même si cela impliquait le massacre des paysans présents sur ces terres pour les renvoyer vers Haïti. Tous les prétextes étaient permis pour justifier cette opération.
Enfin, il convient de mentionner la question du racisme sous-jacent en République dominicaine et la quête d’une identité hispanique distincte. Avant de persécuter un peuple ou une communauté, la première cible est souvent leur représentation. Cela a conduit à la propagation d’un discours raciste et discriminatoire visant à établir une différence entre les Dominicains, considérés comme civilisés selon les normes occidentales, et les Haïtiens, dépeints comme des barbares africains. Cette représentation négative a servi de prétexte pour éliminer la présence haïtienne afin de préserver la pureté des Dominicains.
Ces événements tragiques sont les conséquences mêmes d’un massacre perpétré à l’encontre d’un peuple qui ne faisait que réclamer de meilleures conditions de vie. Les deux États de l’île ont collaboré pour étouffer l’affaire, en empêchant, au nom de la coopération bilatérale, toute enquête de la commission tripartite visant à faire la lumière sur cette affaire. Une résolution dans laquelle le chef d’État de l’époque, Sténio Vincent, a adopté une posture de soumission face à l’hégémonie croissante de la République dominicaine.
Plus de 86 ans se sont écoulés depuis ces événements, et il n’existe toujours pas de mémorial pour rappeler cette période sombre de l’histoire, ce massacre. Les victimes et leurs descendants vieillissent, et la plupart d’entre eux ont déjà disparu. La construction du canal sur la rivière Massacre ravive l’espoir de rendre justice à la mémoire de ces victimes. Il est essentiel de mener à bien ces travaux et d’ériger un monument pour que les souvenirs de 1937 perdurent, afin que personne n’oublie.
La construction de ce canal va bien au-delà de la question de l’autonomie alimentaire. C’est une manifestation de l’autodétermination d’un peuple qui résiste aux défis de la mondialisation.
Richecarde Célestin