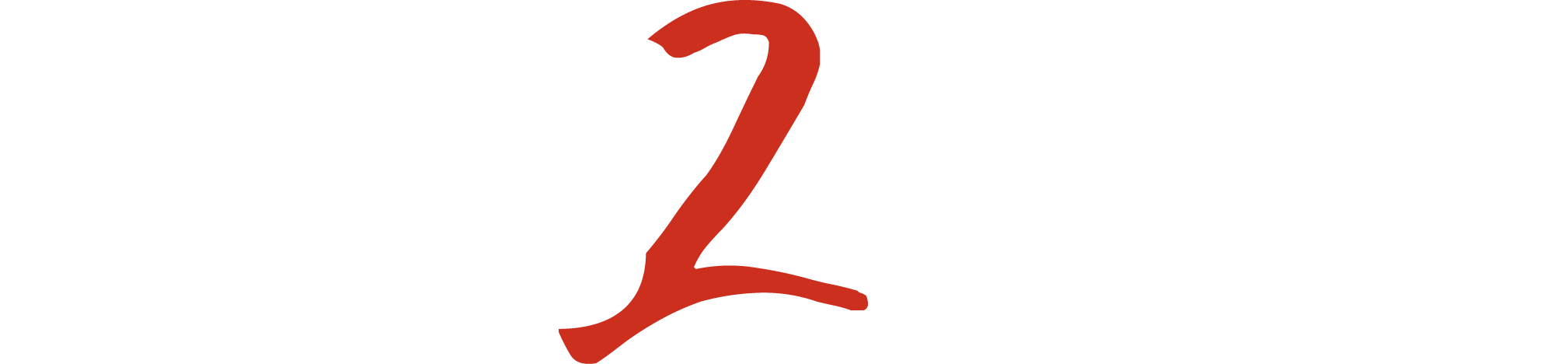Si l’histoire ne fournit pas de réponses précises sur la réalité traversée par un peuple, elle offre des pistes à explorer pour obtenir des réponses sur une conjoncture politique, économique et sociale. Le 8 janvier 1806, selon l’historien Michel Soukar intervenant sur Radio Métropole, les États-Unis ont imposé un embargo sur Haïti. La raison en est que, étant eux-mêmes esclavagistes, il leur est inconcevable de reconnaître ou même d’avoir des relations avec un pays où son peuple a violemment renversé un système économique garantissant leur prospérité. Après 1804, Haïti a été isolé sur la scène internationale pour avoir battu les troupes napoléoniennes et renversé l’ordre social esclavagiste de l’époque. Les élites haïtiennes de l’époque ont cherché la reconnaissance diplomatique internationale, car selon elles, l’État émergent qui a suivi 1804 possède toutes les qualités d’un État moderne.
Cette quête de reconnaissance internationale a conduit à l’acceptation de l’ordonnance de Charles X, qui, 21 ans après son indépendance, a placé Haïti sous l’emprise du capitalisme financier occidental. Le néocolonialisme, selon Benoît Joachim, s’est ainsi installé de manière durable. Au début du 20ème siècle, Haïti est tombé sous la coupe violente des États-Unis. Alors que son économie était en pleine expansion, les États-Unis ambitionnaient les mêmes méthodes que les anciennes puissances coloniales impliquées dans la première guerre mondiale. À la suite de la guerre hispano-américaine pour le contrôle de Cuba, les États-Unis ont affiché une position impérialiste et ont fait des Caraïbes leur arrière-cour, ce qui a conduit à diverses interventions dans les pays de la région caribéenne, Haïti n’étant pas épargné.
Le débat sur le colonialisme est et sera toujours d’actualité. Même si la traite transatlantique et l’esclavage ont pris fin, l’héritage colonial de cette époque reste vivace, en particulier dans les relations établies entre les anciens colonisateurs et les colonisés. Dans leur altérité, qui les missionne à être les propagateurs de la civilisation pour les nations non blanches, les anciens maîtres ont souvent eu recours à la barbarie. C’est-à-dire que, dans une logique de supériorité, ils ont construit une image violente des nations soumises à leur domination.
Tout était organisé pour et par la métropole, le système de l’exclusif organisant une société internationale où les anciens colons imposaient leur culture et leur vision, empêchant, au nom de la civilisation, que d’autres se développent parallèlement à la leur, quitte à les détruire complètement pour assurer leur hégémonie. C’est ce rapport que les États-Unis entretiennent toujours avec Haïti depuis l’occupation américaine. Les politiques néolibérales conçues à partir des années 70 ont trouvé un terrain fertile pour leur application.
En 1986, la démocratie rêvée par les Haïtiens était une démocratie qui réorientait l’État vers le peuple. De 1986 à 1994, l’enthousiasme populaire a porté au sommet de l’État un président qui, selon eux, représentait celui qui avait combiné à lui seul les revendications fondamentales et s’apprêtait à les réaliser. Mais le secteur réactionnaire, doublé de l’impérialisme américain, avait également son propre agenda démocratique. Ne pouvant arrêter le processus en marche, ni empêcher l’application du projet national de la constitution de 1987, ils ont préféré réprimer violemment le mouvement et ouvrir la voie au populisme de droite, réduisant ainsi le mouvement populaire à sa plus simple expression.
C’est l’application de cet agenda qui est à l’origine des nombreux malheurs que connaît Haïti aujourd’hui, avec la misère, l’insécurité et d’autres armes économiques et politiques utilisées contre la population haïtienne. Le plus paradoxal dans tout cela est que, de leur position de maîtres, les États-Unis dictent quel régime peut bénéficier de la reconnaissance internationale, surtout de l’aide internationale, et se positionnent en censeur de la politique en Haïti.
Après plus de 30 mois de crimes, de deuils et de migrations forcées, la crise a atteint son paroxysme. Dans son discours à la nation, le Premier ministre, assuré du soutien américain, montre une fois de plus son cynisme. Combien de morts faudra-t-il encore pour que cette géopolitique criminelle puisse se maintenir ? C’est une question de dialogue, de propositions. Mais combien de propositions ont été méprisées par le pouvoir en place ? Finalement, quel sera le prochain épisode de cette sinistre série ? Encore une fois, des réponses non apportées. Un pas de plus vers l’incertitude, la peur, le désespoir.
Mag..2 News