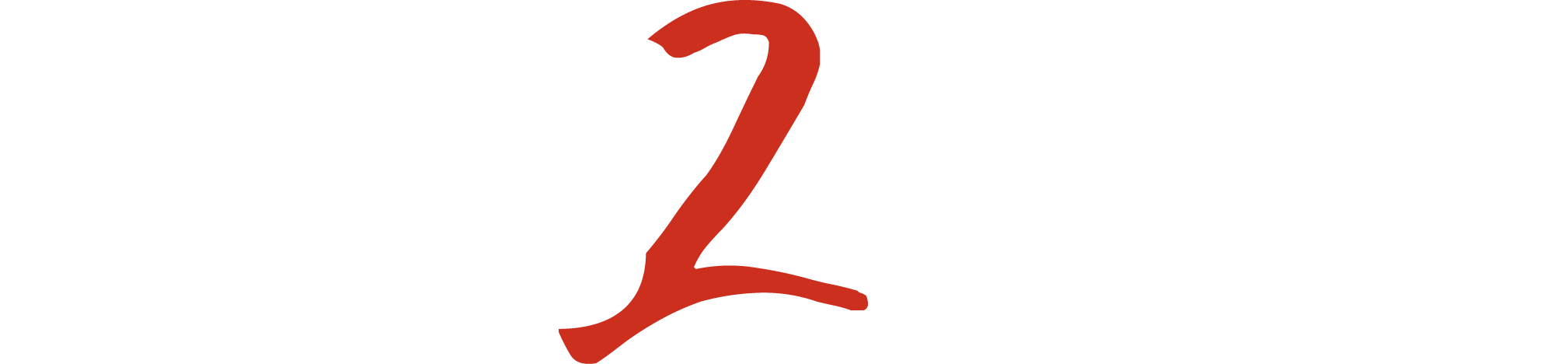« Aucun projet de liberté pour les habitants de Saint-Domingue ne pouvait s’édifier ni se consolider sans l’appui des masses. Pour cela, il fallait les traiter comme des êtres humains et non comme du bétail. » L’histoire rapporte que ces paroles sont attribuées à Moïse Louverture, neveu de Toussaint Louverture, alors gouverneur général de la colonie de Saint-Domingue. Ces propos font écho à une révolte de cultivateurs dans le nord de la colonie, à la Plaine du Nord, où Moïse avait été affecté. Toussaint Louverture chargea Dessalines, alors lieutenant, et Christophe, également lieutenant, de mater cette rébellion.
Moïse Louverture fut capturé et fusillé. Selon divers récits historiques sur cette période révolutionnaire de la colonie, l’exécution de Moïse par Toussaint lui coûta le soutien des masses populaires, surtout après l’arrivée de l’expédition de Napoléon dirigée par Leclerc. Les exactions commises par cette force militaire, ainsi que la nouvelle du rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe, ont marqué la phase finale de la guerre de libération menant à l’indépendance du territoire, dont le 18 novembre 1803 est une date significative.
Le livre « La Guerre de l’Indépendance dans le Sud, » écrit par Marcelin Jocelyn en 1935 et publié par les Éditions de C3 dans la Collection Textes Retrouvés sous la direction de Michel Soukar, est un ouvrage incontournable pour comprendre la réalité historique et idéologique derrière la date du 18 novembre. Cette journée est un moment de réflexion et de mobilisation, où les Haïtiens se rassemblent en petits groupes pour approfondir leur compréhension du symbolisme de cette date. Marcelin Jocelyn réalise un travail de réhabilitation de l’action populaire pendant la révolution menant à l’indépendance de la colonie.
Dans ce texte, Marcelin Jocelyn aborde principalement la question idéologique qui sous-tend la mémoire du 18 novembre 1803. Étant donné que la bataille de Vertières a eu lieu dans le Nord, les pères fondateurs officiels ont tendance à s’approprier entièrement les retombées de la guerre, engendrant des divisions liées à la question de la couleur. Ensuite, l’auteur évoque de nombreux faits survenus dans l’Ouest et le Sud, tels que le Concordat de Damiens, l’organisation et la résistance des affranchis face à la menace des Blancs, ainsi que l’affaire des 300 Suisses, qui demeure une marque indélébile dans la lutte des affranchis pour l’application du décret leur accordant l’égalité civile et politique avec les Blancs.
La partie la plus captivante du texte réside dans la résistance des esclaves des Plantons dans le Sud contre les oppresseurs de toutes les couleurs, qu’ils soient Blancs, mulâtres ou noirs. Cette révolte a été initiée sept mois avant celle de la plaine du Nord en janvier 1791, et les révoltés du Sud n’ont jamais déposé les armes. Des noms illustres, bien que tombés dans l’oubli au nom de la lutte des classes et de l’hégémonie des pères fondateurs officiels, demeurent dans les mémoires : Gilles Benech, Samedi Smith, Goman, Lamour Derance ont résisté. Une alliance entre ces deux groupes d’indépendantistes, symbolisée par l’entrevue de Camp Gérard, aurait-elle eu lieu sans ces figures marquantes ? Cependant, les intérêts de classes et la préservation de l’ordre colonial ont poussé les pères fondateurs officiels à les éliminer et, du même coup, à les effacer de l’histoire de la révolution.
Il est indéniable qu’il y a eu des figures majeures telles que Dessalines, Christophe, et Pétion, mais Sans Souci, Goman, Samedi Smith, Gilles Benech, pour n’en nommer que quelques-uns, ont également contribué, par leur influence dans le Sud, à l’édification de la Révolution et aux idéaux qu’elle porte. Cependant, le fait que l’indépendance ait émergé d’un rejet de tout projet a transformé les masses populaires, qui ont lutté pour la liberté de la manière la plus violente, en cultivateurs assujettis à un ordre néocolonial.
L’État formé après 1804 nie totalement leurs revendications. La leçon à retenir est claire : si la question populaire n’est pas résolue par la mise en place d’un État inclusif reconnaissant leurs droits fondamentaux, l’instabilité persiste. L’avertissement de Moïse, datant de plus de 200 ans, reste sans écho.
Richecarde Célestin | Opinion